Le Québec aura une Présidence
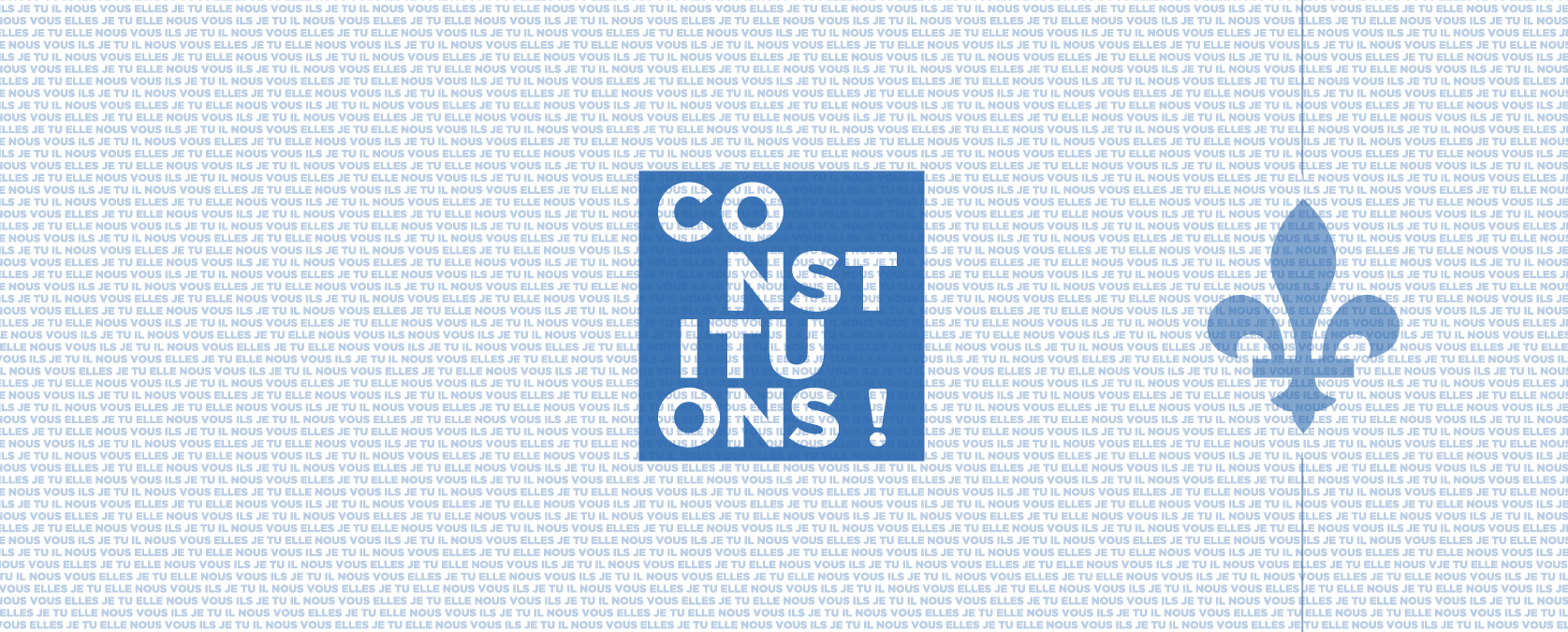
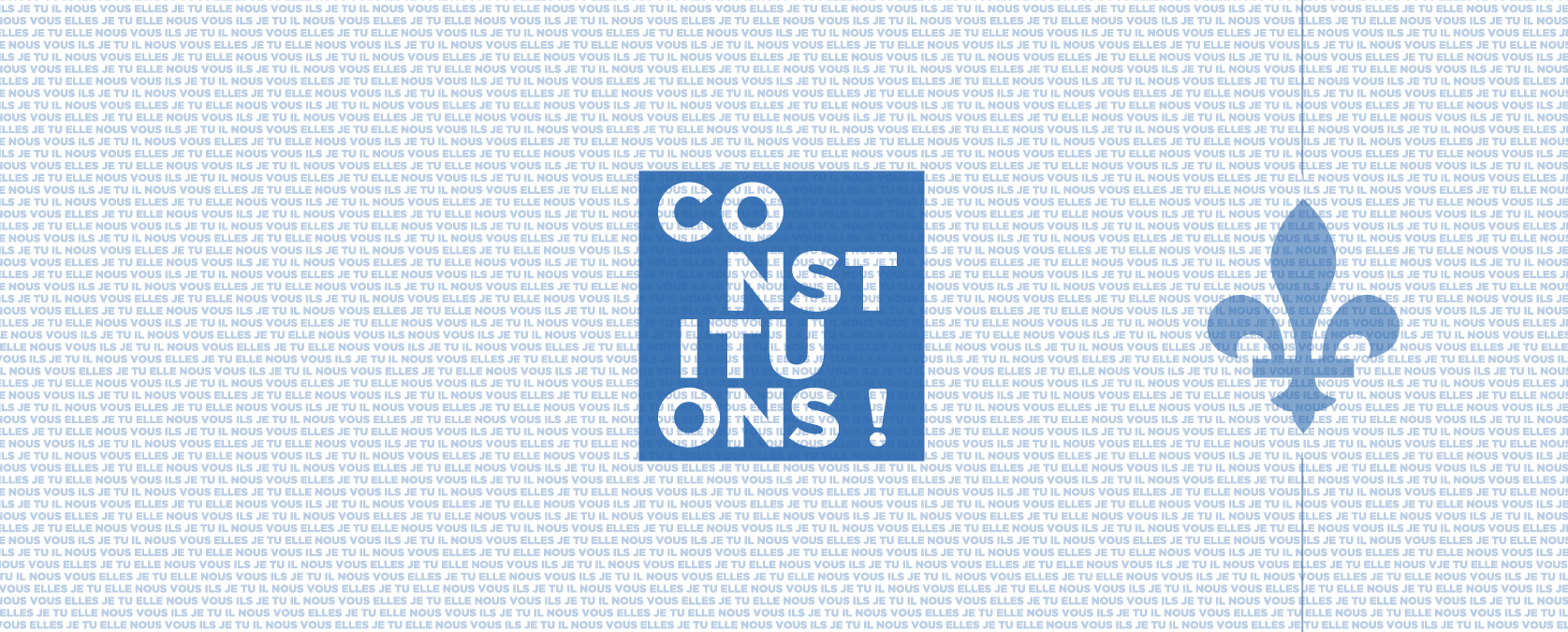
Demandez à un groupe composé de citoyennes et de citoyens, sélectionnés de manière à représenter le plus fidèlement possible la population du Québec, de décider lui-même de son régime politique, et il aura tôt fait d’abolir la monarchie et de se doter d’un régime présidentiel. Simplement, sans débat, à l’unanimité.
C’est ce qu’a démontré l’Assemblée constituante du projet Constituons! dont le projet de Constitution citoyenne du Québec a été déposé hier à l’Assemblée nationale du Québec.
Cet exercice, inédit dans l’histoire québécoise, celui de confier à des personnes non élues issues de la société civile, libres de pressions politiques et de celles de tout lobby, libres, en somme, de décider de leur propre avenir démocratique, a mené à la publication d’un texte de 80 articles qui témoignent d’une volonté réelle de renverser radicalement l’état actuel de notre régime politique.
L’écriture et l’adoption des articles de ce texte se sont déroulées tout au long des mois d’avril et de mai. Les 41 membres de l’Assemblée constituante, qui ont adopté à la quasi-unanimité le texte de cette Constitution[1], ont prouvé, par le dialogue, sans acrimonie, sans se déchirer, qu’il était possible d’imaginer les bases d’une société capable d’affronter les crises humaines et environnementales actuelles et à venir. Un exemple de maturité démocratique, de sensibilité et d’intelligence collective.
Ensemble, ils et elles ont produit un texte qui a comme grand mérite de nous projeter vers l’avenir, tout en s’appuyant sur ce qui nous caractérise profondément comme société distincte. Un texte qui ne cherche pas à être revendicateur, mais qui propose, comme des évidences, plusieurs révolutions.
Une nation inclusive et pacifiste
Les considérations qui précèdent les articles de la Constitution font du Québec « une terre de justice et d’épanouissement humain ». La population québécoise y est caractérisée comme « pacifique et [ouverte] à la différence ». La société québécoise y est vue comme « avant-gardiste, soucieuse de l’équité intergénérationnelle », à l’écoute des revendications de ses citoyens et citoyennes, une société « résiliente et progressiste, ayant à cœur le mieux-être » de sa population. L’État québécois est considéré comme étant un État de droit qui reconnaît l’égalité de toutes les personnes qui vivent sur son territoire, un État francophone qui reconnaît la diversité linguistique, notamment les langues que parlent les peuples autochtones.
À la suite de tous ces « considérants », on propose dans la Constitution unensemble de droits et de devoirs qui témoignent d’un souci sincère de liberté, d’épanouissement, d’inclusion. L’importance accordée à l’éducation, dont le droit est reconnu dès le deuxième article, ainsi qu’un souci de préserver et transmettre la langue française et la culture francophone tissent la trame de fond de cette Constitution, qui n’hésite pas, par ailleurs, à assumer une responsabilité envers la préservation de la langue et de la culture francophone hors-Québec (art. 66), tout comme envers les savoirs, les langues et les cultures des peuples autochtones du Québec (art. 61).
Une constitution pour le XXIe siècle
C’est toutefois le souci de préserver l’environnement qui prime dans l’ensemble de cette Constitution citoyenne. En tout, près d’une quinzaine des 80 articles concernent les questions environnementales. La Constitution prévoit entreautres des dispositions (art. 53) attribuant au fleuve Saint-Laurent et ses affluents une personnalité juridique. Un droit à un « environnement sain, sécuritaire et suffisant » (art. 10) est reconnu avec l’ambition de préserver l’eau potable, les éléments naturels et les écosystèmes qui entretiennent la vie dans une visée intergénérationnelle.
Si certains de ces aspects environnementalistes de la Constitution pourront soulever certaines questions (comme la disposition (art. 2) conférant un droit à « l’éducation à l’environnement et à l’écocitoyenneté »), ou auraient mérité de meilleures définitions (on pense au « devoir d’implanter un processus de développement durable » (art. 5)), la prise en compte de l’importance d’exploiter les ressources naturelles dans une visée intergénérationnelle et écologique, tout comme les obligations en matière de protection et de réparation de l’environnement que contient cette Constitution sont nécessaires pour affronter les défis réels que nous imposent la crise environnementale dont nous subissons toujours plus de conséquences.
Les nombreux enjeux contemporains se retrouvent aussi dans certaines préoccupations énoncées face aux enjeux du numérique qui, même si elles conduisent à des articles parfois peut-être trop spécifiques et qui pourraient être rapidement désuets en raison des évolutions technologiques, ont pour mérite de reconnaître des droits fondamentaux comme le droit à l’oubli (art. 14), le droit à la vie privée et à la sécurité numérique (art. 13).
La reconnaissance de droits à l’accès à l’information (art. 12) et à « un contenu médiatique et informationnel de qualité qui préserve l’identité culturelle québécoise » (art. 11), couplés à un « devoir moral » de voter (art. 20) ouvrent quant à eux la voie à des réformes démocratiques majeures et à des idées surprenantes et tout à fait inspirantes qui se posent comme un véritable remède au cynisme.
Les révolutions évidentes
Lors de l’assemblée de proposition, qui s’est tenue à Québec au début du mois d’avril, deux des dispositions les plus singulières de cette Constitution ont été adoptées sans la moindre opposition, sans le moindre débat, le plus simplement du monde : celle abolissant la fonction de lieutenant-général et supprimant toute référence à la monarchie des lois du Québec (art. 79), tout comme celles faisant du Québec un régime présidentiel (art. 22 à 28).
Alors que certaines autres propositions nouvelles proposent de petites révolutions démocratiques dont devraient s’inspirer nos gouvernements actuels, comme celles prévoyant la possibilité de tenir des référendums d’initiative populaire (art. 70) et un pouvoir d’initiative populaire permettant à tous les citoyens de déposer un projet de loi moyennant l’appui de 25 000 personnes (art. 71), la proposition de se doter d’un régime présidentiel et le rejet de la monarchie ont des conséquences considérables sur notre avenir politique.
Par ces mesures, l’Assemblée constituante se place d’office en défaut face à la Constitution du Canada, signée par la Reine. En ce sens, les 41 personnes ayant réfléchi et écrit cette Constitution citoyenne démontrent avec force que le peuple québécois possède un esprit profondément républicain, en porte-à-faux avec notre régime actuel. Car, comme le proposait Roméo Bouchard dans le mémoire qu’il a déposé lors de la phase de consultation de Constituons!, la question déterminante de la rédaction d’une constitution au Québec est celle-ci :
Voulons-nous écrire la constitution d’une province qui s’inscrit dans le système de monarchie constitutionnelle canadien ou d’une République fondée sur la souveraineté du peuple? Car il faut bien comprendre que les deux sont inconciliables et comportent des institutions politiques et un modèle de démocratie totalement différents.
Bref, on ne peut élire un président dans un Canada dont le chef d’État réside à Buckingham Palace. Les idées contenues dans la Constitution citoyenne,adoptée par les 41 membres de l’Assemblée constituante, qui mettent en place une Cour constitutionnelle, émettent des propositions fort intéressantes en regard de la répartition des pouvoirs législatif et exécutif, exposent plusieurs mesures de participation citoyenne et confèrent la souveraineté au peuple, par l’intermédiaire d’une personne élue à la Présidence du Québec, l’Assemblée constituante souligne à grand traits, toutes les contradictions de notre système politique actuel.
Les autrices et les auteurs du texte ont opté pour l’autonomie de l’État québécois. La Constitution citoyenne, qui évite soigneusement les termes souveraineté ou indépendance,propose un article clé prévoyant que le « Québec ne concède aucune compétence autre que celles négociées d’égal à égal dans un véritable contexte confédératif, où l’existence juridique du Québec ne dépend que de lui-même, sans soumission à un quelconque ordre juridique qui ne relève pas de lui » (art. 62). C’est par cet article que ce texte constitutionnel parvient à se détacher des contraintes constitutionnelles canadiennes, figées depuis 1982, et pour encore longtemps.
S’il y a peu de chance que le projet Constituons! fasse réapparaître à luiu seul quelque débat constitutionnel que ce soit à court ou moyen terme entre le Québec et le Canada, le travail accompli par les membres de l’Assemblée constituante, épaulés par l’INM et toutes les personnes ayant participé de près ou de loin aux nombreuses consultations populaires tout au long de l’année, pourra certainement inspirer l’actuel travail de réforme du mode de scrutin. C’est déjà ça.
Mais les idées que contient cette Constitution citoyenne méritent beaucoup plus que de petites réformes. Le travail exceptionnel accompli, avec peu de moyens, en très peu de temps, avec un investissement sérieux et sincère par les 41 membres de l’Assemblée constituante, démontre que les citoyennes et les citoyens du Québec sont amplement aptes à décider par eux-mêmes de leur avenir. Les riches idées que proposent ces 80 articles, bien que parfois équivoques ou discutables, ont le pouvoir de nous permettre d’imaginer un autre Québec que celui qui, actuellement, semble s’enfoncer « pragmatiquement » dans la division, le cynisme, et l’immobilisme sclérosant. À cet égard, cette Constitution citoyenne du Québec se doit d’être lue, partagée, diffusée et devrait inspirer, le plus vite possible, l’adoption officielle d’une constitution pour le Québec.
[1] 39 votes en faveur, 1 vote en défaveur et 1 abstention.